Schopenhauer « Le fondement de la morale »
« Le fondement de la morale » est à l’origine un texte rédigé par Schopenhauer dans le cadre d’un concours organisé par la Société Royale des Sciences du Danemark en 1810. Il a été publié pour la première fois en 1841.
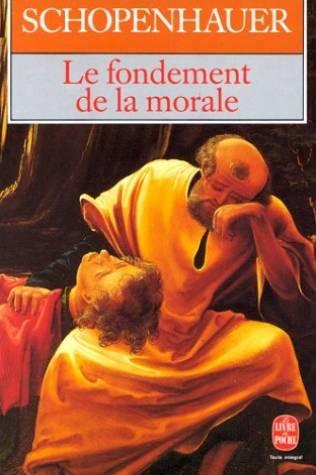
Dans sa première partie, Schopenhauer commence par analyser et critiquer l’œuvre de Kant et tout particulièrement sa « Fondation de la métaphysique des mœurs » concernant le sujet du concours. N’ayant lu cette œuvre de Kant, il m’est impossible d’évaluer la pertinence de la critique effectuée par Schopenhauer, ceci expliquant aussi sans doute le côté confus que j’ai trouvé à cette partie du texte. Ceci étant d’autant plus remarquable que l’on trouve plus généralement chez Schopenhauer une véritable volonté de clarté et d’accessibilité qui le rend très lisible.
Dans un deuxième temps, l’auteur quitte Kant pour exposer sa propre théorie quant au fondement de la morale, qu’il place dans le sentiment de pitié, cette aptitude à « se mettre à la place d’autrui » et à compatir à ses malheurs.
Sa théorie repose donc sur un sentiment humain et non sur des concepts (ce qui l’éloigne de Kant), ce qui aboutit à une philosophie que l’on pourrait qualifier d’ « incarnée » loin de toute spéculation abstraite (le penseur qui pense la pensée…). C’est un aspect très appréciable qui contribue aussi à l’intelligibilité de sa pensée. On quitte la métaphysique à proprement parler pour s’approcher de la psychologie, mais en gardant un regard philosophique.
Dans son analyse de la morale, Schopenhauer propose trois sentiments différents qui se partagent le cœur humain :
- L’égoïsme qui est le sentiment le plus banal poussant l’individu à tout acte qu’il croit pouvoir lui profiter d’une façon ou d’une autre, à plus ou moins long terme. Sont donc incluses toutes les volontés de faire le bien mais en vue de bénéfices réels ou imaginaires : renommée, reconnaissance, « salut de son âme »…
- La méchanceté qui caractérise l’être trouvant son bonheur dans le mal qu’il peut faire subir à autrui, y compris si ses actes malveillants finissent par lui porter lui-même préjudice. Cette méchanceté peut donc aussi s’opposer à sa manière aux aspirations purement égoïstes de l’individu.
- La pitié (et ses corollaires tels que la justice) qui au contraire pousse l’individu à venir en aide à autrui ou à minima à ne pas le léser d’une façon ou d’une autre, même s’il y trouverait un intérêt personnel. Ce sentiment peut donc nous amener à des actes contrecarrant nos intérêts directs ou indirects et même nous inciter à placer l’autre devant soi.
C’est donc sur ce dernier sentiment que se base toute morale selon l’auteur, en faisant bien la différence avec les « fausses » bonnes actions qui seraient en fait motivées par des intérêts à longs termes voire chimériques ou encore la conséquence d’une éducation ou d’une discipline.
Si, comme dit plus haut, cette théorie est très « incarnée » puisque se basant sur des sentiments humains, vers la fin son texte, Schopenhauer ébauche néanmoins une théorie métaphysique tentant d’expliquer ce phénomène.
Il tente de démontrer que loin d’être une illusion, le fait de s’identifier à autrui est au contraire une preuve de lucidité, en se rapprochant notamment de la spiritualité orientale qui nous indique l’existence d’une âme universelle commune à chaque être vivant derrière les apparences illusoires (maïa) d’individuation du monde phénoménal. Ce sentiment de pitié s’il est sincère en deviendrait presque une expérience mystique nous rapprochant de l’« Absolu ».
Peut-être Schopenhauer pour être cohérent avec sa pensée, aurait-il dû examiner plus profondément comment la méchanceté derrière son apparente opposition à la piété peut-elle partir du même instinct de non différenciation des êtres, si ce n’est que quand la première veut se fondre dans le « grand tout », l’autre s’imagine elle-même cet absolu personnifié ce qui lui donnerait le droit de manipuler selon son bon plaisir ces « autres » qui ne sont pas vraiment « autres », dans un solipsisme sadique. On peut reprendre l’illustration utilisée par Schopenhauer du rêveur et des personnages s’animant dans son rêve qui sont effectivement les différents avatars d’une seule et même personne.
Dans cette optique seul l’égoïsme serait complètement en erreur en ne voyant pas « soi » dans les autres…
Extraits et citations issus de la traduction d’Auguste Burdeau
Pour la brute, il n’y a d’idées qu’intuitives, et par conséquent de motifs que du même ordre : c’est pourquoi ses actes de volonté dépendent de ses motifs, cela est évident. L’homme n’est pas moins sujet à cette dépendance : lui aussi, dans les limites de son caractère propre, est gouverné avec la plus absolue nécessité par ses motifs. Seulement ces motifs-là, le plus souvent ne sont pas des intuitions, ce sont des idées abstraites, c’est-à-dire des concepts, des pensées, qui à leur tour résultent de perceptions antérieures, d’impressions venues du dehors. Il y gagne une liberté relative, c’est-à-dire qui se voit quand on le compare à la bête. Car ce qui le détermine, ce n’est plus comme pour la bête, son entourage sensible, celui du moment, mais ses idées, qu’il a tirées de ses expériences passées, ou acquises par l’éducation. Le motif qui le détermine nécessairement, ne s’offre pas aux yeux du spectateur en même temps que l’acte : c’est l’auteur qui le porte avec lui, dans sa tête. De là, non seulement dans l’ensemble de sa conduite et de sa vie, mais jusque dans ses mouvements, un je ne sais quoi qui les fait distinguer au premier coup d’œil d’avec ceux de la bête : il a l’air mené par des fils plus ténus, invisibles ; tous ses actes par suite ont un caractère de prévoyance et d’intention, et de là tirent un semblant d’indépendance, par où ils tranchent sur ceux des animaux très visiblement. Or toutes ces différences, si marquées, tiennent à la faculté des idées abstraites, des concepts.
Ainsi s’explique à mon sens, l’étymologie du mot conscience : il n’y a de conscient que le fait authentique. Ainsi, chez tout homme, même le meilleur, s’élèvent des sentiments, qu’excitent des causes extérieures, ou bien, à l’occasion d’un trouble intérieur, des pensées et des désirs impurs, bas, mauvais : mais en bonne morale, il n’en est pas responsable, et sa conscience n’en est pas chargée. Tout cela montre de quoi est capable l’homme en général, mais non pas lui. Chez lui, il y a des motifs différents qui s’opposent à ceux-là ; sans doute ils ne se sont pas présentés en ce même instant ; mais les autres n’en sont pas moins incapables de se manifester par des actes : ils sont comme une minorité impuissante dans une assemblée délibérante. C’est par nos actes seulement et par expérience que nous apprenons à nous connaître, nous et les autres ; et les actes seuls pèsent sur notre conscience. Seuls ils ne sont pas problématiques, comme les pensées, mais au contraire certains (gewiss), ils sont là, désormais impossibles à changer, ils ne sont pas simplement objets de pensée, mais bien de conscience (Gewissen).
Qu’est-ce en somme que la conscience ? C’est la connaissance que nous prenons de notre moi lui-même à force d’en considérer la conduite propre, et qui devient de plus en plus profonde. Aussi c’est à l’esse que la conscience s’en prend : l’operari n’est que l’occasion de ses reproches. Or, comme la liberté ne nous est révélée que par la responsabilité, là où se trouve celle-ci, doit être aussi la première : elle réside dans l’esse. Quant à l’operari, il tombe sous le coup de la nécessité. Maintenant, nous n’apprenons à nous connaître, nous-mêmes et les autres, que par expérience, nous n’avons pas de notre caractère une notion a priori. Au contraire, nous commençons par nous en faire une très haute idée : car l’axiome « quisque proesumitur bonus, donec probetur contrarium » [tout individu est présumé honnête, jusqu’à preuve du contraire] vaut aussi dans notre prétoire intérieur.
Le seul univers que chacun de nous connaisse réellement, il le porte en lui-même, comme une représentation qui est à lui ; c’est pourquoi il en est le centre. Par suite encore, chacun à ses yeux est le tout de tout : il se voit le possesseur de toute réalité ; rien ne peut lui être plus important que lui-même.
En cherchant à exprimer brièvement la force de cet agent ennemi de la moralité, j’avais songé à dépeindre d’un trait l’égoïsme dans toute sa grandeur, et je tâchai de trouver à cet effet quelque hyperbole assez énergique ; je finis par prendre celle-ci : plus d’un individu serait homme à tuer son semblable, simplement pour oindre ses bottes avec la graisse du mort. Mais un scrupule m’est resté : est-ce bien là une hyperbole ?
– Mais en réalité, le droit de mentir va plus loin encore : ce droit m’appartient contre toute question que je n’ai pas autorisée, et qui concerne ma personne ou celle des miens : une telle question est indiscrète ; ce n’est pas seulement en y répondant, c’est même en l’écartant avec un « je n’ai rien à dire », formule déjà suffisante pour éveiller le soupçon, que je m’exposerais à un danger. Le mensonge en de tels cas est l’arme défensive légitime, contre une curiosité dont les motifs d’ordinaire ne sont point bienveillants.
- Cette vérité, le sanscrit en a donné la formule définitive : « Tat twam asi »,« Tu es cela »; elle éclate aux yeux sous la forme de la pitié, principe de toute vertu véritable c’est-à-dire désintéressée, et trouve sa traduction réelle dans toute action bonne. C’est elle, en fin de compte, que nous invoquons quand nous faisons appel à la douceur, à la charité, quand nous demandons grâce plutôt que justice ; car alors nous ramenons notre auditeur à ce point de vue, d’où tous les êtres apparaissent fondus en un seul. Au contraire l’égoïsme, l’envie, la haine, l’esprit de persécution, la dureté, la rancune, les joies mauvaises, la cruauté viennent de l’autre idée, et s’appuient sur elle. Si nous sommes émus, heureux en apprenant, et plus encore en contemplant, mais surtout en accomplissant une action généreuse, c’est au fond que nous y trouvons une certitude, la certitude qu’il y a au-delà de la multiplicité, des distinctions mises entre les individus par le « principium individuationis », une unité réelle, accessible même pour nous, car voilà qu’elle se manifeste dans les faits.