Bernard Lenteric – Les enfants de Salonique : une trilogie qui se joue à quatre
Cette œuvre est une trilogie dont les trois tomes (Les enfants de Salonique – La femme secrète – Diane) totalisent plus de 1400 pages. Un roman fleuve donc, ce qui pouvait un peu rebuter le lecteur escargot que je suis. Toutefois, connaissant déjà Bernard Lenteric par certains de ses autres romans (« L’Empereur des rats » / « Le Prince Héritier » et « La Nuit des enfants rois »), je savais son style très accessible et captivant.
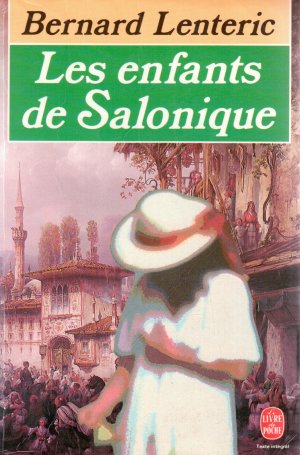
Je n’ai pas été déçu par la lecture de cette trilogie car Bernard Lenteric sait tenir son lecteur en haleine tout le long de son texte et on se retrouve vite entrain de dévorer ses centaines pages sans s’ennuyer un instant. Bref, il ne faut pas se laisser impressionner par la longueur du récit, qui reste au final très digeste. Je me surprends même à déplorer certains raccourcis effectués par l’auteur, surtout dans le troisième tome. J’aurais très bien pu concevoir encore quelques tomes supplémentaires à ce roman fleuve tant les mésaventures de ses personnages captivent le lecteur.
Je n’ai pas l’intention de résumer ici en quelques mots une œuvre de cette dimension, et je dirais juste que vous y trouverez tous les ingrédients qui font un bon roman :
- de vrais « héros » sortant du commun : Démosthène le poète maudit et politique félon plus ou moins malgré lui ; Basile le « maître du monde », marchand d’armes sans scrupule et au charisme implacable, Périclès l’esprit nomade, épris de liberté et d’idéal et évidemment Diane, la « femme secrète » et idéalisée, située au centre névralgique de ce trio à quatre.
- un scénario entraînant avec la dose de tragédie qui convient pour donner du piment à l’histoire, le tout dans une intrigue mélangeant évènements personnels de la vie des personnages et histoire mondiale dans divers pays durant la période trouble du début du 20ᵉ siècle.
Le tout est mené avec le sens de la mise en scène qui fait reconnaître le producteur de film, une des autres casquettes de Bernard Lenteric.
Mais principaux bémols iront vers les ficelles ont peu trop grosses qu’il utilise principalement à certains passages du troisième tome (par exemple, la façon dont Diane trouve « par hasard » la lettre de Démosthène) qui laisse penser que l’auteur lui-même commençait à avoir du mal à faire le lien entre toutes les trames de son roman. Si en tant que lecteur, je ne refuse pas d’être mené par le bout du nez puisque c’est la nature de tout roman, je demande à ce que cela se fasse de manière suffisamment subtile pour que je ne m’en rende pas compte.
Pour conclure, s’il ne s’agit sans doute pas de « grande littérature », c’est un roman d’aventure de qualité qui ne devrait pas vous décevoir s’il vous prend de le parcourir.
Pour vous donner l’eau à la bouche, voici 2 extraits tirés du tome 2 (La femme secrète) :
[…] Du coup, après les va-t-en-guerre et les romantiques, c’était au tour des esprits réfléchis et circonspects d’applaudir le même homme. La voix mâle et les talents oratoires de Démosthène faisaient le reste. Il prenait son auditoire au ventre et le lâchait plus. Il ne débitait ni plus ni moins de sornettes et de grands mots creux que la plupart des hommes politiques de toutes les époques, mais il le faisait à la perfection. Il y avait longtemps qu’il ne croyait plus une seule syllabe de ses discours, mais il les assenait avec la conviction d’un acteur de haute volée. Même Bousphoron, même Basile subissaient alors son charme. Démosthène était sympathique. Démosthène était chaleureux. Démosthène était humain. Il incarnait pour chacun le frère, l’ami, le compagnon d’armes, et pour les plus âgés le fils ou le gendre idéal… Tout cela n’était qu’un faux-semblant, il avait livré son ami Hélianthos aux Turcs, il avait trahi sa patrie, il avait bafoué sa femme, il avait assassiné un malheureux infirmier à Brindisi, mais nul n’en savait rien, et l’imprudent qui se serait levé pour dire la vérité se serait fait écharper par la foule. Il n’y avait pas de meilleur candidat que Démosthène. Si rien ne venait entraver son ascension, il serait élu triomphalement à la boulê et il entrerait bientôt au gouvernement.
[…] Partagé entre l’incrédulité et l’horreur, Démétrios relut plusieurs fois le télégramme. Puis il le laissa tomber sur son bureau, et se prit la tête entre les mains. Ce télégramme résumait la faillite de toute une vie. Diane se trouvait à bord du train dont il avait ordonné la destruction. Elle allait mourir, par sa faute, de sa main. Or, dans le cœur desséché du vieux marchand de canons, il n’y avait de tendresse que pour elle, pour la fille de son frère Kostas dont, vingt ans auparavant, il avait provoqué la mort, par sa dureté, par son âpreté en affaires. À ce souvenir, un sanglot lui déchira la poitrine. Il était donc maudit, pour causer ainsi le malheur de ceux qu’il aimait ? Les flots de sang versés à cause des armes vendues au monde entier retombaient sur la tête de ses proches. Il n’avait vécu que pour le pouvoir et pour l’argent. Tout au long de sa vie, dans son pays et ailleurs, il avait fait et défait des ministères, acheté des hommes politiques, corrompu des fonctionnaires, infléchi la politique des grandes puissances. Il avait amassé des fortunes, prélevé lors du dernier affrontement gréco-turc sa dîme sur chaque balle, sur chaque obus tiré par les deux camps. Chaque soldat tué ou estropié lui avait apporté quelque chose. Il était un des vrais maître du monde, de ceux qui décident en secret de la vie et de la mort de millions d’hommes. Mais aujourd’hui il n’était plus qu’un vieillard désespéré. Son existence n’avait été qu’un terrible et pitoyable gâchis.
Il ouvrit un tiroir de son bureau, et en sortit un revolver. Jamais une arme plus parfaite n’était sortie de ses armureries Mascoulis. Elle était exceptionnelle. Un outil à tuer de haute précision. Les balles elles-mêmes avaient été fondues et serties une à une par un vieil ouvrier chevronné, chargé des clients les plus exigeants.
Démétrios chargea le revolver et le rangea dans le tiroir après avoir mis le cran d’arrêt. Il n’avait plus qu’à attendre. Quand il aurait la certitude que Diane était morte, il se tirerait une balle dans la tête. En dehors de l’immense dégoût qu’il ressentait envers sa misérable personne, il n’y avait place sans son esprit que pour un sentiment de curiosité : qui pouvait bien être l’enfant dont Fallope parlait dans son message ? Diane avait consulté les meilleurs gynécologues d’Europe. Elle ne pouvait pas avoir d’enfants…